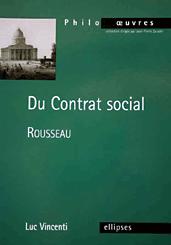
Du Contrat social (Rousseau)
Paris, Ellipses, 2000 (64 p.).
Relire le Contrat social est une gageure, tant les interprétations ont été riches et diversifiées. Mais cela ne rend que plus nécessaire une nouvelle synthèse, tant pour l’actualité de la réflexion philosophique que pour revenir vers le texte lui-même. Luc Vincenti propose une lecture suivie, se saisissant des difficultés majeures du texte pour dépasser l’opposition des interprétations. La situation du Contrat social dans l’ensemble de la philosophie rousseauiste permet ce dépassement, que ce soit en rapportant le statut de l’individu au couple (amour de soi / amour-propre) ou en repensant les rapports entre domaine politique et domaine moral-religieux. Des textes fondamentaux, commentés dans l’esprit universitaire, ainsi qu’un vocabulaire levant plusieurs ambiguïtés font de ce petit ouvrage un instrument indispensable pour la préparation des concours.
Table des matières :
PRÉSENTATION. Rousseau, philosophe politique? La philosophie politique du Contrat social. La place du Contrat social dans la philosophie pratique de Rousseau.
TEXTES COMMENTÉS : le droit du plus fort (livre I, ch. 3) ; le pacte social : données du problème (livre I, ch. 6) ; l’homme civil (livre I, ch. 8) ; le dégagement de la volonté générale : modèle mathématique (livre II, ch. 3) ; la volonté générale : condition anthropologique (livre II, ch. 4).
VOCABULAIRE.
Extraits :
Du Contrat social (Rousseau), Paris, Ellipses, 2000, pp. 21-25 :
« Que le droit naturel moderne se définisse comme tel parce qu’il distingue le domaine juridico-politique du domaine moral-religieux ne veut pas dire qu’il ne faille pas penser le rapport du politique à la moralité-vertu ou moralité-religion. Il faut bien au contraire, à l’époque moderne, articuler ces domaines qui s’enchaînaient dans la pensée de Platon ou d’Aristote. Rien n’interdit d’ailleurs, une fois posée la spécificité respective de ces domaines, de penser leur articulation en rejoignant les auteurs antiques et en subordonnant le politique aux fins de la moralité. Accorder un rôle au politique dans le perfectionnement de la nature humaine ne semble pas étranger à la pensée de notre auteur : de la première version du Contrat social affirmant « nous ne commençons proprement à devenir homme qu’après avoir été citoyens »[1], jusqu’au célèbre chapitre huit du livre un que nous commenterons ci-dessous et qui fait sans conteste de la vie politique l’élément du perfectionnement de la nature humaine. En inscrivant le politique dans le chemin de ce perfectionnement, la philosophie politique prendrait elle-même place dans l’édifice d’une philosophie pratique qui enjoindrait l’individu-citoyen à reconnaître la place de l’individu-homme dans le monde et à se rapporter ainsi à l’auteur de son être.
Toutefois, le rapport du politique à la religion tel que nous le présente le Contrat social ne ressemble guère à cette reprise de la pensée classique. Dès l’intervention du législateur, au chapitre sept du livre deux, loin que le politique soit subordonné à une dimension morale-religieuse, c’est bien plutôt le législateur, cherchant à entraîner et persuader les hommes sans pouvoir user ni de force ni de raison, qui utilise le religieux « pour entraîner par l’autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la puissance humaine »[2]. Au-delà de l’institution du corps politique, ce même rapport d’instrumentation se retrouvera, explicitement thématisé comme tel pour le fonctionnement même du corps, c’est-à-dire quand la nécessité se fait sentir à l’individu-citoyen de remplir ses devoirs en pouvant aller jusqu’à l’encontre des désirs et volontés de l’individu-homme, homme qui peut toujours mener une existence individuelle et séparée. L’esprit de corps peut exiger le sacrifice de soi, ou du moins de ce que l’individu-homme, menant une existence individuelle et séparée, considère comme son Moi. Alors l’État a besoin de religion : « il importe à l’État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs »[3]. Ce n’est donc pas seulement « dans l’origine des nations »[4] que la religion sert d’instrument au politique, c’est d’une façon bien plus essentielle puisqu’elle attache les individus à l’État en pénétrant les consciences et permet ainsi de préserver l’unité du corps social.
Mais cet office est parfaitement rempli par ce que Rousseau appelle les « religions nationales », paganisme primitif que le christianisme a dépassé. Ces religions apprenaient aux citoyens « que servir l’État c’est en servir le Dieu tutélaire […] Alors mourir pour son pays c’est aller au martyre, violer les lois c’est être impie [etc.] »[5]. Certes, ces religions nationales sont exclusives, et rendent les peuples sanguinaires et intolérants. N’y aurait-il les inconvénients des guerres auxquelles conduisent les religions nationales, elles conviendraient exactement à ce qu’attend le politique du religieux. Pourquoi donc aller jusqu’à construire une religion nouvelle, la religion civile, distincte des religions nationales ? A ne considérer que la stricte nouveauté de la religion civile – son dogme négatif prônant la tolérance – la religion civile peut fort bien apparaître comme une simple correction des inconvénients liés au particularisme des religions nationales. Ces inconvénients sont proprement politiques : les religions nationales mettent chaque peuple « dans un état naturel de guerre avec tous les autres, très nuisible à sa propre sûreté » ; ces inconvénients doivent donc comme tels être corrigés par le politique lui-même. Après tout, la référence à Hobbes nous commande bien « de tout ramener à l’unité politique »[6]. La religion civile serait ainsi un retour aux bienfaits des religions nationales, en palliant leurs inconvénients quant aux relations avec les autres États, et en assurant, tout comme les premières théocraties, l’unité du corps politique. La religion civile pallierait aussi du même coup les inconvénients du christianisme ne pouvant garantir l’unité de l’État, et cela qu’il soit compris comme religion du prêtre, christianisme romain divisant l’autorité, ou religion de l’homme, « vrai théisme », détachant les citoyens de l’État « comme de toutes les choses de la terre »[7].
Mais ces raisons seraient seulement politiques, et précisément, le point de vue de la religion, même envisagé dans un traité de philosophie politique, nous conduit au-delà du point de vue politique. C’est au point de vue seulement politique que le vrai christianisme, religion de l’homme, se trouve récusé dans le dernier chapitre du Contrat social. La religion de l’homme ne l’est pas au point de vue moral et religieux qui la reconnaît comme véritable. De même, les religions nationales ne sont pas seulement condamnées pour les inconvénients qu’elles entraînent au point de vue seulement politique ; la religion nationale ou religion du citoyen est d’abord récusée au point de vue moral et religieux : « elles est mauvaise en ce qu’étant fondée sur l’erreur et sur le mensonge elle trompe les hommes, les rend crédules, superstitieux, et noye le vrai culte de la divinité dans un vain cérémonial »[8]. On ne peut donc se borner à voir dans la religion civile un simple retour aux religions nationales, une fois corrigés leurs inconvénients politiques.
Et pour les mêmes raisons on ne peut se borner à l’instrumentation du religieux par le politique. La place du chapitre sur la religion civile à la fin de l’ouvrage a un sens pour l’articulation du politique et de la morale : elle indique leur continuité possible, au-delà de leur spécificité respective. Conformément aux précisions fournies par la première des Lettres écrites de la Montagne[9], la religion civile rassemble ce qui, dans la vraie religion, peut être prescrit par l’État parce que cela concerne l’unité du corps politique. La religion civile a une utilité politique, mais c’est en tant que vraiment religieuse que la religion civile sert l’État, et le sert mieux que ne pouvait le faire les religions construites à partir du politique seul. Comme l’ont depuis longtemps fait remarquer les commentateurs, les dogmes positifs de la religion civile recouvrent ceux de la Profession de foi du vicaire savoyard. Le dogme négatif – la tolérance – signifie plus qu’un reflet des propres oscillations de Jean-Jacques entre protestantisme et catholicisme. La tolérance résume toute l’opposition entre religion civile et religions nationales : elle est ce qui permet à la généralité du politique – et donc à la particularité de chaque État – de coexister avec l’universalité de la vraie religion.
Du fait que nous ayons effectivement pénétré dans le religieux s’ensuit que nous pouvons conclure en revenant sur les rapports entre le politique et le moral-religieux. Le politique est sans conteste élément du perfectionnement de la nature humaine. Mais cela ne veut pas dire que la vie politique soit le lieu de l’accomplissement de cette nature humaine. Pensons à Émile : adulte, il se tient prêt à servir l’État, mais son précepteur ne l’engage nullement à épouser une carrière politique ou militaire[10]. Les jours heureux qu’il vit – du moins dans un premier temps – avec Sophie nous montrent que la fin de la vie humaine n’est pas dans le politique, même si elle ne peut être que par lui. La fin de la vie humaine est ailleurs, précisément là où l’individu trouve son bonheur. Que la vie humaine ne puisse se résumer au politique nous permet d’orienter ce politique, de le subordonner à des fins qui ne sont pas seulement les siennes, c’est-à-dire qui ne se résument pas à préserver l’unité de l’État. Paradoxalement, ces fins n’interdisent pas à l’État d’engager les individus à sacrifier leur être pour le bien public. Mais le bien public ne se définissant plus alors par le politique seul, il doit être subordonné à l’ordre de l’univers, et le sacrifice de son être peut alors se justifier au regard d’un bien-être que l’individu lui-même atteint par là : « quelle félicité plus douce que de se sentir ordonné dans un système où tout est bien ? »[11]. Dans l’héritage de Malebranche, cette félicité se situe au-delà de l’être, dans un bien-être qui le dépasse. Et ce bien-être pour être parfait ne peut s’en tenir à l’État. Ce serait tronquer la philosophie de Rousseau que de confondre ce système où tout est bien, ordre de l’univers, avec un État. Rousseau sait fort bien que les fins des États, qui se conduisent entre eux comme les individus en deçà de tout droit et dont les actes sont loin d’être tous légitimes, s’accordent rarement avec l’ordre du monde. »
Du Contrat social (Rousseau), Paris, Ellipses, 2000, Vocabulaire :
Aliénation. « Aliéner, c’est donner ou vendre » écrit Rousseau de façon lapidaire au chapitre quatre du livre un du Contrat social. Rousseau cherche alors à récuser l’absolutisme contractuel, conçu sur le modèle de l’esclavage contractuel, où l’esclave vend sa liberté pour conserver sa vie. Le contexte oriente l’aliénation vers un sens fort, celui qu’elle revêtait déjà dans le Discours sur l’inégalité : « le bien que j’aliène me devient une chose tout à fait étrangère, et dont l’abus m’est indifférent »[12]. Le Discours poursuivait en remarquant que je ne puis être indifférent à l’usage que l’on fait de ma liberté, et posait donc déjà de l’inaliénable au fondement du droit. Retenons, concernant le terme même, que ce sens fort est aussi celui qu’il revêt dans le domaine moral où Rousseau condamne toute aliénation dans l’opinion d’autrui. Il y a là aussi aliénation au sens fort, puisque c’est la conscience de soi-même qui est alors déportée dans le regard de l’autre. Au fond Rousseau rejette l’aliénation morale pour la même raison que l’aliénation politique : elle est perte d’identité, c’est-à-dire perte du soi dont je ne puis être conscient qu’à partir de l’unité de mon être ; « tout ce qui rompt l’unité sociale ne vaut rien : Toutes les institutions qui mettent l’homme en contradiction avec lui-même ne valent rien »[13].
Aliénation totale. Rousseau valorise l’aliénation lorsqu’elle prend la figure extrême de l’aliénation totale, clef du pacte social. Cette transformation de la quantité en qualité se comprend ici de deux manières. L’aliénation totale est aliénation de tout et de tous, mais à la communauté, c’est-à-dire à personne en particulier. Elle n’est donc pas le lieu d’une soumission, mais au contraire celui d’une libération des rapports d’autorité interindividuels. Du point de vue des biens également, on ne donne rien à personne, mais tout à la communauté qui a précisément pour mission de garantir par la force publique ainsi constituée la sécurité des biens. Cette aliénation totale s’avère donc un « échange avantageux »[14]. Elle est ainsi le contraire de l’aliénation, même au sens fondamental : c’est vraiment lui-même que l’individu retrouve dans le citoyen, au-delà des oppositions de l’état de guerre et des identités déconstruites par l’égoïsme et l’amour-propre. S’il fallait retrouver ici ce qu’Engels reconnaîtra comme dialectique, nous aurions aussi, en plus de la transformation de la quantité en qualité, une négation de la négation.
…/…
Liberté (morale). Elle correspond au fait de vaincre ses passions, entendons par là les passions mondaines, issues de l’amour-propre, qui engendrent haine, dissension, et séparent l’homme de lui-même. De ce fait, la liberté morale constitue un effort intérieur et revêt un caractère vertueux : « sois libre en effet […] commande à ton cœur Ô Émile, et tu seras vertueux »[15]. La raison joue alors en morale un rôle indispensable, en présentant l’ordre du monde aux yeux de l’égoïste qui rapporte tout à lui. Mais la raison seule ne suffit pas à réorienter ces rapports, elle peut aussi servir l’égoïste qui veut rester « le centre de toutes choses »[16]. Il faut lui adjoindre la conscience, ultime transformation de l’amour de soi, pour engager l’homme à rester à sa place, et à se subordonner à l’ordre du monde pour vivre ainsi le rapport à son auteur.
Liberté (naturelle). La liberté naturelle est celle de l’individu primitif, qui fait tout ce qu’il veut, s’il le peut. Parfaite indépendance envers autrui, elle est étroite dépendance envers la nature. La volonté reste alors intacte de toute soumission à quiconque, mais les forces de l’individu sont très limitées et cette liberté a tôt fait d’être ineffective. Elle se réalisera dans la liberté politique, si tant est que les influences néfastes de la société et les préjugés de l’éducation permettent l’institution d’une société légitime avant d’avoir complètement perverti la liberté naturelle ; sur cette liberté naturelle et sa perversion, cf. Émile II pp. 308-310.
Liberté (politique). Elle est indépendance envers la volonté d’autrui et s’obtient grâce à des institutions évacuant tout rapport d’autorité interindividuel. Dans le pacte social, « chacun se donnant à tous ne se donne à personne »[17], les citoyens sont garantis « de toute dépendance personnelle »[18]. La liberté politique est ainsi supérieure à la liberté naturelle, puisque la force publique, infiniment supérieure à celle d’un individu ou d’une simple agrégation d’individus, réalise effectivement la volonté générale. Mais pour être indépendant d’autrui, les citoyens sont dans une étroite dépendance envers la cité. Il importe donc de ne pas séparer cette liberté politique de la participation non moins étroite de chacun des membres à l’élaboration de la volonté générale.
Moral(e). Il y a au moins trois sens de « moral » chez Rousseau. Le premier, très fréquent, est indifférent aux points de vue éthique et religieux, il concerne le mental en opposition au physique ; cf. Discours sur l’inégalité , p. 156 : « commençons par distinguer le moral du physique dans le sentiment de l’amour ». « Moral » peut tout au plus en ce sens désigner la vie passionnelle. C’est alors seulement, dans la mesure où l’anthropologie concerne la morale, que « moral » peut avoir une dimension axiologique. Le deuxième sens est issu du premier et renforce sa neutralité axiologique : il s’agit toujours d’une distinction d’avec le physique comme naturel, pour désigner ce qu’ont d’artificiel les conventions interhumaines ; cf. Discours sur l’inégalité, exorde, où Rousseau distingue deux sortes d’inégalités « l’une que j’appelle naturelle ou physique, parce qu’elle est établie par la nature […] l’autre que l’on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu’elle dépend d’une sorte de convention ». Que l’association issue du pacte soit « un corps moral et collectif » ne signifie donc pas qu’elle a pour fin la vertu. Le troisième sens seulement concerne les domaines éthique ou religieux, moralité-vertu liée à l’idée d’un effort qui n’est pas nécessairement un sacrifice, parce que le retrait du monde est retour en soi.
…/…
Volonté générale. L’expression est pratiquée par Malebranche pour désigner le gouvernement divin du monde, mais l’usage moral et politique est issu de Diderot qui l’emploie avant Rousseau dans l’article « Droit naturel » de l’Encyclopédie. Il s’agit alors d’une volonté sinon rationnelle du moins raisonnable, qui enveloppe morale et politique et concerne le genre humain. Rousseau reprend le terme en un sens très proche dans l’article « Économie politique ». Mais sa doctrine évolue et tout en restreignant la notion à la communauté politique, il se sépare de Diderot dès le Manuscrit de Genève, pour ne plus voir la raison mais l’amour de soi au fondement de ce qui permet à chaque individu d’apercevoir en lui-même l’intérêt commun et de participer ainsi à l’élaboration de la loi.
[1]. Manuscrit de Genève, I, 2, p. 287.
[2]. Contrat social II 7 p. 384.
[3]. Ibib. IV 8 p. 468.
[4]. Ibib. II 7 p. 384.
[5]. Ibib. IV 8 p. 465.
[6]. Ibib. IV 8 p. 463.
[7]. Ibib. IV 8 p. 465.
[8]. Ibib.
[9]. L’objet du chapitre huit du livre quatre est décrit ainsi dans la premières des Lettres écrites de la Montagne, p. 703 : « examiner comment les institutions religieuses peuvent entrer dans la constitution de l’Etat ».
[10]. Cf. Emile V p. 859/860.
[11]. Emile IV p. 603.
[12]. Discours sur l’inégalité p. 183/184.
[13]. Contrat social IV 8 p. 464.
[14]. Ibid. II 4, p. 375.
[15]. Emile V p. 818.
[16]. Ibid. IV p. 602.
[17]. Contrat social I 6 p. 361.
[18]. Ibid. I 7 p. 364.