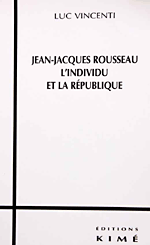
Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République
Paris, Kimé, 2001.
Qui voudrait ordonner la masse considérable des interprétations de l’œuvre philosophique de Rousseau retrouverait la disjonction dont J.W. Chapman fit le titre de son ouvrage[1] : « Rousseau, totalitaire ou libéral ? ». Les interprétations font la part belle à la pensée politique de notre auteur qui a le triste privilège d’être parmi les plus exploités idéologiquement. Son propre engagement et le retentissement du Contrat social dans les débats de la Révolution française expliquent bien sûr cela. Mais la disjonction de Chapman, exprimant l’opposition des interprétations en des termes contemporains, ne reflète pas seulement ces exploitations idéologiques. En faisant des rapports entre individu et communauté l’enjeu de la pensée rousseauiste, le politique nous offre un point de vue sur l’ensemble de l’œuvre. L’anthropologie de Rousseau tout d’abord, dont l’analyse de la vie passionnelle se développe autour de la distinction entre amour de soi et amour propre, compose les deux catégories dont nous disposons pour penser l’individualité et ses rapports à ses semblables ou à la communauté : la singularité et la particularité. La métaphysique ensuite, sur fond de laquelle se construit l’anthropologie, et qui, étudiant le rapport de l’homme à Dieu, voit en l’amour de Dieu l’ultime transformation de l’amour de soi. L’individu est donc objet de la pensée rousseauiste. Il est aussi ce qui en constitue l’originalité dans la mesure où Rousseau n’a jamais opté pour une des voies de l’alternative au dépens de l’autre, orientation « holiste » ou « individualiste ». Témoin en est, après la condamnation de l’individualisme lié à l’amour-propre, puis les louanges de la vie citoyenne, le retour vers une pensée de l’individu, voire, puisque l’accomplissement de la vie humaine nous conduit finalement jusqu’aux extases égotistes de la contemplation, le retour vers l’individu Jean-Jacques Rousseau lui-même. Il faut donc aujourd’hui que le commentaire revienne à son tour vers l’œuvre de Rousseau, pour saisir, à partir de la pensée de l’individu qui constitue son originalité, la cohérence et l’unité philosophique de la doctrine.
Le premier chapitre de cet ouvrage retrouve la méthode rousseauiste et cherche à déterminer l’identité de l’individu essentiel. La méthode rousseauiste nous conduisant vers l’individu essentiel par abstraction, il nous faudra tout d’abord redonner consistance à cet individu en composant les trois caractères qui le définissent : amour de soi, liberté et perfectibilité. Ces trois caractères se réunissent en une conscience de soi liée à la satisfaction, et qui fait donc de l’amour de soi le support de l’identité individuelle. Il faut encore déterminer la spécificité proprement humaine de cet individu mû par l’amour de soi, passion commune à tout être sensible. Le deuxième chapitre accomplit cette tâche en définissant plus précisément l’amour de soi comme n’étant ni égoïsme ni altruisme, puis en analysant l’amour de soi selon le dualisme de l’homme rousseauiste. L’identité de l’individu humain peut alors être pensée de façon dynamique, l’unité de l’amour de soi se trouvant dans la recherche d’un bonheur d’abord simplement corporel puis spirituel. Nous pouvons ainsi présenter, dans un troisième chapitre, l’accomplissement de cette nature humaine, tout à la fois comme déploiement des facultés virtuelles et dépassement de la naturalité de l’individu primitif.
Le dépassement de cette naturalité se produit dans l’élément même où a lieu le déploiement de la nature humaine : l’histoire. Mais la perfection n’est pas le seul possible du devenir humain et la dégénérescence demeure le réel de notre histoire, même dans le cadre du politique auquel Rousseau confère pourtant la mission de corriger l’évolution historique. Outre le rappel de la dégénérescence passionnelle, le chapitre quatre prend en compte la nécessaire articulation de la dégénérescence et de son dépassement pour repenser le rapport entre le politique réel et le politique légitime. La proximité du Discours sur… l’inégalité et du Contrat social est alors envisagée pour comprendre l’inscription du politique légitime dans l’histoire. Le chapitre cinq étudie ensuite ce qui, dans le fonctionnement du politique légitime, permet de corriger la dégénérescence passionnelle : il ne s’agit pas seulement de l’éradication de l’amour-propre, ni même du développement de la raison, mais surtout du rôle fondamental et souvent mal compris de l’amour de soi. Le chapitre six peut alors présenter les acquis moraux du citoyen, sans superposer pour autant morale et politique. Il faut faire la part entre les acquis positifs du devenir passionnel dans la vie civique, et le fait que cette dernière, circonscrite dans la particularité d’une patrie, ne peut prétendre à l’universalité de la vie proprement morale.
Le chapitre sept souligne cette universalité qui s’appuie sur l’utilisation pédagogique de la pitié au livre quatre d’Émile. Le chapitre huit présente alors l’accomplissement de la vie morale en vie morale-religieuse, à la rencontre du sentiment que la pitié étend sur tout le genre humain et de la raison nous faisant connaître, à son plus haut degré de développement, l’ordre de l’univers. L’individu réalisant sa perfection se rapporte à l’ordre du monde par l’amour de soi, support persistant de son identité, qui prend ici la forme de l’amour de Dieu en tant qu’auteur de l’être individuel. Ce rapport à l’auteur du monde fait l’objet du dernier chapitre. Il manifeste le déplacement de l’amour de soi que nous pouvions déjà apercevoir dans la vie citoyenne, mais qui est maintenant fondé sur le bien véritable. Nous retrouvons ainsi la félicité accompagnant la conscience d’un Moi qui va au-delà de lui-même, en dépassant, dans une thématique malebranchiste, son être vers son bien-être.
Table des matières :
INTRODUCTION. “ Totalitaire ou libéral ? ”
PREMIÈRE PARTIE. L’INDIVIDU ESSENTIEL. Chapitre un. Isolement et identité. Chapitre deux. Amour de soi et nature humaine. Chapitre trois. L’Homme perfectionné.
DEUXIÈME PARTIE. L’HOMME CIVIL. Chapitre quatre. La genèse historique du pacte social. Chapitre cinq. La genèse anthropologique du pacte social. Chapitre six. La fonction morale du politique (la vertu civique).
TROISIÈME PARTIE. LA VIE MORALE. Chapitre sept. Morale et politique? (l’universalité et la pitié). Chapitre huit. Morale et politique? (le statut de la religion). Chapitre neuf. La félicité.
CONCLUSION. SAUVER LE POLITIQUE.
BIBLIOGRAPHIE.
Extraits :
Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001, chapitre deux, pp. 73-77,Une identité dynamique, de la sensibilité à la spiritualité :
« L’amour de soi est donc bien une passion double, et il nous faut maintenant reconstruire son unité, au risque de perdre son identité, et avec elle celle de l’individu essentiel. Cette fin peut ici nous guider : la nature humaine consiste en un dualisme qui ne nous interdit pas pour autant de penser son unité ; comment ? Sans pouvoir parler de continuité, nous avons déjà vu qu’il y a, dans les deux substances, identité quant à la recherche du bien. Et il n’y a pas seulement répétition de cette recherche qui définit l’amour de soi ; cette recherche, dans les deux substances, s’effectue dans l’élément du bien. Amour de soi corporel et amour de soi spirituel sont bons tous deux, même s’ils sont bons différemment et si leur bien-être « n’est pas le même »[2]. Nous pouvons penser cette identité et cette différence dans une progression nous menant de l’un à l’autre, de l’amour de soi corporel à l’amour de soi spirituel. Le dualisme de la nature humaine n’est plus alors un modèle permettant de penser l’unité de l’amour de soi, il est cette unité même : l’unité de l’amour de soi et celle de la nature humaine se définissent conjointement par cet ordonnancement de la recherche du bien nous élevant vers la meilleure partie de nous-mêmes, élévation qui nous procure la plus grande des satisfactions. Il s’agit bien d’une élévation qui accomplit la recherche du bien porté par la nature corporelle. La thématique malebranchiste est très présente, qui fait de la recherche du bien et de la satisfaction un désir d’union avec ce qui nous rend plus parfait[3] : les liens entre amour de soi et liberté[4] nous permettent de comprendre que le bien choisi n’est véritablement mon bien, et donc également ce vers quoi je voulais m’orienter, que dans la mesure où il représente une perfection de ma nature. Nous reviendrons sur ce perfectionnement de la nature humaine dans notre troisième chapitre. Précisons pour le moment les modalités de cette recherche ordonnée du bien qui définit conjointement amour de soi et nature humaine. Trois points sont à développer : la continuité de cette recherche, au sens où elle s’enracine dans la nature sensible tout d’abord ; en rapport à cette continuité ensuite il nous faut rappeler que la distinction des deux substances est d’ordre métaphysique et non moral ; c’est en cela finalement que la recherche du bien peut s’accomplir dans la substance spirituelle, et que cet accomplissement peut être celui de la nature humaine tout entière, qui se réalise en dépassant son dualisme.
L’unité de l’amour de soi, qui risquait de mettre en cause l’identité de celui-ci, se situe donc dans la recherche du bien, que cette recherche ait lieu dans l’intelligible ou le sensible, qu’il s’agisse de l’enfant aimant ce qui le conserve ou du philosophe chrétien aimant l’auteur de son être. L’ordre intelligible et l’ordre sensible, au bien-être distinct, sont deux voies permettant de rechercher la satisfaction, et nous ne devons pas réduire la dualité de ces voies puisque cette dualité constitue la nature humaine que nous cherchons à mieux définir par la spécificité proprement humaine de l’amour de soi. Le dualisme est constitutif, originaire, et ne peut être dépassé que par la mort qui est, pour Rousseau chrétien, mort du corps. L’unité de l’amour de soi, pour être bien réelle et représentée par ce que Rousseau appelle « sensibilité » dans le passage du Deuxième dialogue déjà cité[5], ne peut aller plus loin que cette identité formelle dans la recherche du bien.
Toutefois pour être formelle et viser des satisfactions différentes, cette identité de la recherche du bien n’interdit pas de penser une continuité, non entre les deux substances, mais dans la recherche même qui a lieu pour l’une comme pour l’autre. Ici l’étude précédente du dualisme métaphysique, le distinguant sans partage d’un manichéisme moral, a toute son importance. S’il ne pouvait y avoir recherche du bien, et recherche d’un véritable bien qui ne doit pas être condamné moralement, dans l’ordre sensible, alors il ne pourrait y avoir continuité de la recherche de l’ordre sensible à l’ordre intelligible.
Et précisément cette continuité est la seule manière de construire l’unité de la nature humaine malgré son dualisme. Ce que Rousseau pose comme définissant l’humain : la liberté, est en œuvre dès le sensible et oriente l’enfant ou le primitif vers son bien-être corporel. C’est la même liberté que Dieu nous a donnée pour choisir le bien[6] et qui doit nous guider vers lui. La dimension spécifiant l’humain, sa substance spirituelle, posée avec la liberté dans le Discours sur l’inégalité[7] puis dans la Profession de foi[8], constitue l’unité de la nature humaine, mais il s’agit de l’unité d’une recherche et d’un développement orientés vers la perfection de cette nature. La duplicité première de la nature humaine lui impose d’orienter son développement, vers la recherche d’une plus grande unité : unité plus grande et meilleure, car commandée par l’interaction de l’amour de soi et de la liberté qui est liberté pour le bien et donc, puisque ce bien doit provoquer une satisfaction, liberté pour le perfectionnement de soi. La dualité métaphysique de l’homme lui confère donc une identité dynamique. Dès la note XV du Discours sur l’inégalité définissant l’amour de soi, nous pouvions comprendre que ce dernier oriente la perfectibilité vers la perfection, nous conduit de la bonté négative de tout animal « veillant à sa propre conservation » jusqu’à « l’humanité et la vertu ».
Nous retrouvons donc bien finalement l’unité des trois caractères essentiels de la nature humaine, amour de soi, liberté, perfectibilité. Que cette unité se construise, de façon dynamique, dans un dépassement de la naturalité première ne constitue pas une négation de cette naturalité comme composante essentielle de la nature humaine. L’identité de l’individu humain est d’abord pensée comme composé âme / corps, avant que ce corps devienne un poids pour l’âme[9], et que celle-ci cherche à s’en délivrer[10]. La délivrance suppose une culture pour laquelle la longue œuvre éducative du précepteur d’Émile nous a suffisamment montré l’importance du corps. En se délivrant du corps, l’homme n’abandonne pas une partie de son être, il réalise ce qui s’exprimait de façon imparfaite dans la sensibilité et qui trouve, dans le domaine spirituel identifié à la meilleure partie de soi-même, son plein accomplissement : « J’aspire au moment où, délivré des entraves du corps je serai moi sans contradiction, sans partage, et n’aurai besoin que de moi pour être heureux »[11].
Nous ne devons pas exagérer les accents platoniciens associés à cette délivrance du corps. Le dépassement de la duplicité première est enveloppé par cette même duplicité, par le dualisme métaphysique. Parce que ce dépassement s’opère dans la meilleure partie de nous-mêmes il est justification de ce dualisme, justification de ma liaison avec le corps. Justification tout d’abord au sens d’une explication : mon corps est ainsi expliqué parce que sa bonté première se développant en vertu permet d’envisager dès ici-bas une existence harmonieuse des deux substances, dans la mesure du possible. La justification est aussi bien sûr à comprendre comme son salut, qui est alors celui de l’âme pouvant ne pas sombrer dans les passions du corps. Cette justification requiert alors une histoire comme élément où se composent les contraires. La constitution dynamique de l’identité du sujet se joue dans la manière dont ses deux natures se rapportent l’une à l’autre par la continuité de l’histoire de son salut. En soulignant les termes qui concernent notre propos, identité et continuité, cela veut dire qu’étant d’abord individu composé d’une âme et d’un corps, ce que je dois devenir est présent dès les premiers moments de mon existence et s’exprime dans la dimension spécifiquement humaine de l’amour de soi qui tend librement et par choix à rechercher son véritable bien. Ma nature se réalise donc au terme d’un développement, lorsque cette recherche atteint son terme qui est, dans le domaine spirituel, la voix de la conscience au sens très précis que lui donne Rousseau d’instinct divin. Ma nature accomplie est donc le meilleur de moi-même, qui s’affirme dans le domaine spirituel. La conscience fait « l’excellence de ma nature »[12] et résume mon identité, une identité « sans partage »[13], et qui est donc bien par là identité d’un individu.
La question de l’identité individuelle éclairée par la nature de l’amour de soi nous renvoie ainsi vers une dynamique de développement. Cette dynamique, se déployant en une histoire, ne peut se confondre avec l’histoire empirique, qui est histoire de la dégénérescence. C’est l’histoire d’une perfectibilité positive, du déploiement et du développement de la nature humaine telle qu’elle serait sans les perversions de l’amour-propre ; nous envisagerons cette histoire au chapitre suivant. La bonne histoire doit pourtant se réaliser. Elle suit pour cela la mauvaise comme son envers, son négatif, et le développement des qualités naturelles « en puissance » a les mêmes causes ou conditions que celles qui provoqueront la dégénérescence[14]. Cette ambivalence du réel ouvre le domaine de la liberté, et nous enjoint de penser l’articulation de la dégénérescence et du perfectionnement, ce que nous ferons dans notre deuxième partie. »
Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001, chapitre quatre, pp. 108-110 :
« les conséquences sociales de la propriété sont au moins doubles : la même raison qui participe au développement de l’amour-propre sert aussi à concevoir la seule solution permettant de sortir de cet état de guerre. Que ce soient les « raisons spécieuses » du riche concevant « le projet le plus réfléchi qui soit jamais entré dans l’esprit humain », ou la raison des autres contractants, suffisamment développée « pour sentir les avantages d’un établissement politique »[15], les uns comme les autres s’engagent dans la société politique. La fin de l’état de guerre est donc le début de l’histoire politique, au même moment – sur lequel nous reviendrons – où s’instituent les contrats : au terme de la dégénérescence du politique.
Ce moment est le même au chapitre six du livre I du Contrat social et dans le Discours sur l’inégalité. Rousseau reprend les mêmes expressions pour désigner cette inflexion de l’histoire : la première phrase du chapitre six du livre I du Contrat[16] répond au moment de l’institution du politique dans le Discours[17]. La société politique appelée à dégénérer à cause de l’intention de son fondateur, s’institue au même moment de l’histoire que la société politique légitime. Cela signifie qu’au degré zéro de son institution, la société politique réelle, issue du contrat décrit dans le Discours sur l’inégalité, est une réelle société politique. Non seulement nous ne versons pas d’emblée dans le despotisme, mais le contrat du riche institue une société politique légitime. Il faut ici lire très précisément le texte. Que les raisons du riche soient « spécieuses »[18] ne signifie pas que le contrat proposé soit faux. Ce contrat est un bon contrat, au même titre que l’apparence du bien ressemble effectivement au bien et peut en cela nous tromper[19], le contrat du riche a toutes les propriétés d’un contrat social juridiquement valide et atteignant ses fins. Ce n’est pas le contrat qui est trompeur, ce sont les intentions du riche : « il inventa des raisons spécieuses pour les amener à son but »[20]. Le but inavouable est de protéger et d’accroître sa propriété au détriment de celle des autres en détournant à son profit le pouvoir politique. Pour que ce but soit atteint, il ne faut pas le présenter comme tel, mais au contraire prétendre vouloir protéger la propriété de tous en instaurant un pouvoir commun. Si le contrat était faux, le riche n’arriverait pas à tromper si bien les autres contractants, l’usurpation serait moins « adroite »[21]. La possibilité d’utiliser ainsi la société politique repose sur le fait qu’en son fond et telle qu’elle est pensée au XVIIIe siècle, elle défend également la propriété de tous, égalité quant à la défense, mais non quant à la propriété. L’égalité réelle et sociale n’a jamais été l’objet de la doctrine rousseauiste. Même si, du point de vue des biens, les riches font « seuls tous les frais »[22] de l’état de guerre et sont donc ceux qui ont le plus intérêt à en sortir, la défense commune demeure intéressante pour tous, puisqu’il s’agit de protéger la personne avec les biens. Ainsi même les sages « virent qu’il fallait se résoudre à sacrifier une partie de leur liberté à la conservation de l’autre »[23], et rentrer dans la société politique proposée par le riche. Le pacte du riche ne se borne pas à abuser des ignorants faciles à séduire. C’est un vrai contrat, et s’il est bien vicié, il ne l’est ni dans sa forme ni dans contenu – du moins tel que Rousseau, en tant que philosophe politique de la fin du XVIIIe, pouvait envisager ce contenu. Le contrat du riche est vicié dans l’intention de son instigateur, et c’est ce vice qui provoquera la dégénérescence du corps politique. On peut alors concevoir que le contrat légitime soit passé au même moment d’inflexion de l’histoire. Et il est extrêmement important qu’il y ait bien véritable contrat fondateur d’un corps politique, sinon on ne comprendrait jamais comment inscrire le politique légitime dans l’histoire, ce qui est, à ce moment-là précisément, possible. »
Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001, chapitre quatre, pp. 113-115 :
« Lorsqu’on se borne à stipuler qu’il n’y a pas contrat de soumission dans le Contrat social, l’opposition globale entre soumission et association masque la rencontre possible des deux ouvrages en un pacte d’union, premier pacte du Discours et seul pacte du Contrat. Du point de vue de l’institution du gouvernement, il est encore question d’un pacte dans le Discours, il n’y a plus de pacte dans le Contrat social. Et il n’y en n’a plus précisément pour éviter d’interpréter la soumission aux lois comme obéissance à un maître. Mais Rousseau veut-il dans le Discours sur l’inégalité rapprocher la soumission aux lois de l’obéissance à un maître ? Évidemment non, et l’utilisation de la même expression de chef, par opposition à celle de maître, pour désigner, dans les deux ouvrages, la soumission au gouvernement, nous rappelle qu’il s’agit, dès le Discours sur l’inégalité d’une commission qui n’enveloppe absolument aucun transfert ou abandon de droit. « On commît à des magistrats le soin de faire observer les délibérations du peuple » ; cette commission ou mandat signifie, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle – et pour l’auteur tant du chapitre XV du livre III Contrat social que des Considérations sur le gouvernement de Pologne – un mandat impératif. Nous nous accordons complètement sur ce point avec les analyses de V. Goldschmidt[24]. Il faut alors revenir vers le texte. Lorsque Rousseau, dans le Discours sur l’inégalité, appelle l’institution du gouvernement un « vrai contrat », ne pourrait-on penser qu’il s’agit, dans son esprit, de distinguer ce « vrai » contrat d’un contrat de soumission ? Rousseau vient de s’opposer pendant quatre pages[25] à l’abandon de droit qu’envelopperait un contrat de soumission en politique. Ce vrai contrat ne peut donc désigner un contrat de soumission. Et il n’est pas raisonnable d’affirmer, comme R. Masters[26], que Rousseau écrit cela pour ne pas en discuter. Certes, le texte précise bien que l’auteur ne veut pas « entrer aujourd’hui dans les recherches qui sont encore à faire sur la nature du pacte fondamental de tout gouvernement », et va se borner à suivre « l’opinion commune »[27]. Mais précisément, « l’opinion commune » est ici celle de Diderot, notamment et ainsi que l’a montré J. Proust[28], celle qu’il soutient dans l’article Autorité politique où il est explicitement fait mention du contrat de soumission. Ce que Rousseau reprend et ne discute pas encore, c’est la notion de contrat en un sens large, c’est-à-dire appliquée tout à la fois au pacte d’union et à l’institution du gouvernement, cela à cause de Diderot, et parce qu’il n’a pas encore fini d’élaborer la philosophie politique qui sera la sienne dans le Contrat social. Ce que Rousseau rejette de cette opinion commune c’est, comme nous venons de le voir, tout ce qui enveloppe, avec le contrat de soumission, un abandon de droit[29]. Le rapport avec Diderot est donc déjà distant et cela permet de comprendre l’évolution de l’œuvre allant d’un ouvrage encore proche de Diderot, utilisant en tout cas ses termes pour se distinguer de lui s’il le faut, et un ouvrage plus autonome qui ne reflètera plus ce rapport à Diderot. N’oublions pas que Rousseau déclare, à propos du Contrat : « je n’avais voulu communiquer mon projet à personne, pas même à Diderot »[30]. En lisant ainsi, sinon une opposition, du moins une première distance d’avec Diderot dès le Discours sur l’inégalité, et en refusant donc d’interpréter l’acte par lequel un peuple se donne des chefs comme un contrat de soumission, l’argument interprétatif faisant appel à une évolution de l’œuvre n’est plus le seul et la cohérence de la doctrine peut recommencer à s’affirmer, ne serait-ce que progressivement. Rousseau appelle contrat en 1754 ce qu’il n’appellera plus contrat une fois abandonnée l’opinion commune représentée par Diderot et une fois établie la disjonction entre contrat d’association et de soumission. Dans la doctrine définitive, l’institution du gouvernement n’est pas un contrat, c'est un « acte complexe », une loi et un décret[31]. Il faut pour cela que Rousseau ait pu achever le traitement de ces deux actes dans leur rapport, articulant la généralité de la loi à la particularité du décret, ce qui est l’objet du livre trois du Contrat social. Ce n’est pas encore fait en 1754 où Rousseau traite encore de façon très rapprochée (sept pages), ce qui sera ensuite beaucoup plus éloigné : dans le Contrat social, le premier acte fondateur du corps politique est établi au chapitre six du livre un et l’institution du gouvernement au chapitre dix-sept du livre trois. »
Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001, chapitre cinq, Amour de soi et volonté générale, pp. 141-143 :
« En soulignant le rôle fondamental de l’amour de soi dans le corps politique rousseauiste, nous mettons l’accent sur ce qui constitue l’originalité de Rousseau, une fois comprise la signification spécifique que revêt l’amour de soi chez notre auteur. Originalité par rapport à Diderot tout d’abord : le chapitre deux du Manuscrit de Genève, dont il est maintenant admis qu’il s’oppose à l’article Droit naturel de l’Encyclopédie, reprend Diderot sur plusieurs points. Nous avons déjà remarqué, dans notre chapitre deux, que Rousseau s’opposait à la reprise par Diderot du partage « anglais » de l’individu entre passions douces, sociales ou bienveillantes d’une part et égoïsme d’autre part. En outre, comme l’ont déjà montré bon nombre de commentateurs, Rousseau récuse l’existence d’une société générale du genre humain, au sein de laquelle les comportements sont régis et l’égoïsme naturel corrigé par une volonté générale que les individus trouveraient « dans les principes du droit écrit de toutes les nations policées ; dans les actions sociales des peuples sauvages et barbares ; dans les conventions tacites des ennemis du genre humain entre eux […] »[32]. Rousseau récuse non seulement l’existence d’une bienveillance persistante qui compenserait l’égoïsme de l’individu dépravé, mais aussi l’idée que cette bienveillance puisse, sous la forme de la volonté générale proposée par Diderot, régir effectivement cette hypothétique société générale. La forme que Diderot propose pour cette instance corrective est bien connue, il reproduit ici la dichotomie opposant la raison aux passions et superpose volonté générale et raison. Cette thèse n’est pas celle de Rousseau, non seulement parce que l’individu corrompu n’écoutera guère selon lui cette volonté générale, mais encore parce que, dit-il, la raison est insuffisamment développée en tout un chacun pour que le genre humain puisse être l’objet d’une quelconque réflexion rationnelle. Sans même rappeler que la raison ne peut à elle seule contrebalancer les passions, qu’elle n’est qu’instrument et requiert un guide sous peine de servir aussi bien le vice que la vertu[33], il faut souligner que l’opposition à Diderot se comprend comme opposition au rôle que ce dernier fait jouer à la raison, et que Rousseau ne peut donc admettre la définition diderotienne de la volonté générale. Ainsi lorsque notre auteur reprend cette définition dans le chapitre deux du Manuscrit de Genève, il faut minorer la remarque positive venant immédiatement à la suite de cette définition et souligner la critique qui en est faite :
« En effet que la volonté générale soit dans chaque individu un acte pur de l’entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l’homme peut exiger de son semblable, et sur ce que son semblable est en droit d’exiger de lui, nul n’en disconviendra : Mais où est l’homme qui puisse ainsi se séparer de lui-même et si le soin de sa propre conservation est le premier précepte de la nature, peut-on le forcer de regarder ainsi l’espèce en général pour s’imposer, à lui, de devoirs dont il ne voit point la liaison avec sa constitution particulière ? »[34].
Il faut minorer le « nul n’en disconviendra », qui peut d’ailleurs se comprendre en un sens rousseauiste puisque la raison, une fois développée puis guidée par la conscience, pourra commander aux passions mondaines. L’important se trouve dans l’opposition à la définition de cette volonté générale en terme de raison, définition qui impose un partage originaire de l’individu. Ce partage impose également à tous ceux chez qui la raison est insuffisamment développée de s’en remettre à une règle transcendante qu’ils ne peuvent ni comprendre ni sentir. »
[1]. Chapman John W., Rousseau – Totalitarian or liberal ?, New York, Columbia University Press, 1956.
[2]. Ibid.
[3]. Cf. Deuxième dialogue, p. 805 / 806 : « Il est très naturel que celui qui s’aime cherche à étendre son être et ses jouissances, et à s’approprier par l’attachement ce qu’il sent devoir être un bien pour lui ».
[4]. Cf. supra, chapitre un.
[5]. Deuxième dialogue, p. 805 / 806, cf. supra p. Erreur! Signet non défini., « Il y a une sensibilité physique et organique […] Il y a une autre sensibilité que j’appelle active et morale [etc.] ».
[6]. Cf. Émile IV p. 605 et Nouvelle Héloïse III 21 p. 383, VI 7 p. 683.
[7]. Première partie, p. 141.
[8]. Émile IV p. 587.
[9]. Émile IV pp. 590 et 603.
[10]. Ibid., p. 604/605. Cf. également, sur le thème de la délivrance, la fin de la lettre A Malesherbes du 26 janvier 1762 : « Un corps qui souffre ôte à l’esprit sa liberté [...] il faut m’en délivrer pour être à moi ».
[11]. Ibid.
[12]. Ibid. p. 601.
[13]. Ibid., p. 604/605.
[14]. Cf. Discours sur l’inégalité, p. 162.
[15]. Discours sur l’inégalité p. 177.
[16]. « Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation […] », Contrat social I 6, p. 360.
[17]. « Les choses en étant parvenues à ce point, il est facile d’imaginer le reste », Discours sur l’inégalité p. 174, qui lui-même reprend le début de la seconde partie du Discours, « les choses en étaient déjà venues au point de ne plus pouvoir durer comme elles étaient », p. 164.
[18]. Discours sur l’inégalité p. 177.
[19]. Nous pensons évidemment à l’épigraphe du Discours sur les sciences et les arts, « decipimur specie recti » : « nous sommes abusés par l’apparence du bien ».
[20]. Discours sur l’inégalité p. 177.
[21]. Ibid. p. 178. Le terme d’usurpation, employé par Rousseau, nous renvoie lui aussi vers un premier pouvoir légitime, perverti par l’usage.
[22]. Ibid. p. 176 ; de même, p. 179/180.
[23]. Ibid. p. 178. Sans nous accorder avec l’ensemble de la note de la Pléiade qui oppose le Contrat au Discours, on ne peut pas ne pas souligner, à l’instar de J. Starobinski p. 1351, qu’il y a de fortes dissonances entre cette conception de l’aliénation fondatrice des sociétés politiques et les autres textes politiques de Rousseau. Le contexte du Discours nous renvoie bien vers un sacrifice, le chapitre huit du livre un du Contrat présentera la liberté politique comme dépassant la faiblesse de la liberté naturelle et réalisant donc celle-ci en lui donnant une effectivité qu’elle n’avait pas à l’état de nature. Ces dissonances n’influent nullement sur le fait que Rousseau présente bien ici ce qui est à l’époque et à ses yeux une véritable société politique. Que sa philosophie politique évolue ensuite en se séparant nettement de Diderot est un autre point sur lequel nous revenons dans ce chapitre même.
[24]. Anthropologie et politique, Chap. VIII, pp. 675/677.
[25]. Dans le Discours sur l’inégalité – et donc avant le Contrat social – depuis la p. 180 où il commence à être question de cette commission et de ce dépôt, jusqu’à la p. 184 où Rousseau affirme une nouvelle fois sa spécificité dans l’École du droit naturel par la séparation entre la liberté, inaliénable, et la propriété.
[26]. The political philosophy of Rousseau, p. 189.
[27]. Discours sur l’inégalité p. 184.
[28]. Diderot et l’Encyclopédie, chap. X, pp. 372 sqq.
[29]. De ce fait, la critique de la soumission fait retour sur « l’opinion commune ». Si l’on ne doit pas se soumettre purement et simplement à l’exécutif, le rapport au gouvernement, qui ne peut être un acte d’association, peut-il encore être un contrat ? Cet acte ne rentrerait dans aucune des deux catégories de contrat que thématisera le Contrat social, il ne peut être ni association, ni soumission. De ce point de vue, l’essentiel de la doctrine est en germe dès les discussions du Discours.
[30]. Confessions IX, p. 405. Cf. également A Moultou 18 janvier 1762 « Je fais imprimer en Hollande un petit ouvrage qui a pour titre Du contrat social [...] Ce petit ouvrage n’est point encore connu du public ni même de mes amis ».
[31]. La mise en série, sous forme « union / loi / décret », de l’institution du gouvernement rapportant le Contrat social I 6 au Contrat social III 17, permet de souligner l’opposition à Pufendorf et à la série « union / ordonnance / soumission », cf. les Devoirs de l’homme et du citoyen, II, Chap. VI, § 7.
[32]. Encyclopédie, article Droit naturel, pt. VIII.
[33]. Dans le chapitre deux du Manuscrit de Genève, la raison de l’homme indépendant ne le conduira nullement vers la bienveillance. Sur la raison en général et avant que nous lui consacrions des développements plus approfondis dans le chapitre suivant, nous nous accordons ici avec Masters, The political philosophy of Rousseau p. 75 : « Reason is an insufficient basis of virtue [...] reason alone can therefore never overcome the contradiction between that is good for the individual and the common good ».
[34]. Manuscrit de Genève, chap. 2, p. 286.